Wise Young, Ph.D., M.D.
W. M. Keck Center for Collaborative Neuroscience
Rutgers University, Piscataway, NJ
On dit souvent aux personnes atteintes de lésions de la moelle épinière qu’elles ont une lésion à un niveau donné de la moelle épinière. On leur dit souvent que la lésion est « complète » ou « incomplète ». On leur dit parfois qu’elles ont une fracture osseuse ou une autre atteinte d’un ou plusieurs niveaux vertébraux. On peut également leur dire qu’ils sont classés selon la classification de l’American Spinal Injury Association (ASIA), comme ASIA A, B, C, D ou E. Que signifient les différents niveaux de lésion de la moelle épinière, la définition de lésion complète et incomplète et les différentes classifications de lésion de la moelle épinière ? Au début des années 1990, il n’existait pas de définition unique du niveau, du caractère complet de la lésion ou de la classification. Les médecins avaient souvent des définitions différentes des niveaux de lésions de la moelle épinière et des lésions complètes et incomplètes. Dans cet article, je vais essayer d’expliquer les définitions actuellement acceptées des niveaux de lésions de la moelle épinière et de la classification.

Figure 1. Niveaux de la moelle épinière
et des vertèbres.
Niveaux vertébraux par rapport aux niveaux segmentaires de la moelle
La moelle épinière est située dans la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est constituée d’une série de segments vertébraux. La moelle épinière elle-même a des niveaux segmentaires « neurologiques » qui sont définis par les racines spinales qui entrent et existent dans la colonne vertébrale entre chacun des segments vertébraux. Comme le montre la figure de gauche (adaptée d’un site Web d’anatomie de la colonne vertébrale de l’université Emory), les niveaux segmentaires de la moelle épinière ne correspondent pas nécessairement aux segments osseux. Les niveaux vertébraux sont indiqués sur le côté gauche tandis que les niveaux segmentaires de la moelle sont répertoriés pour la moelle cervicale (rouge), thoracique (vert), lombaire (bleu) et sacrée (jaune).
Les segments vertébraux. Il y a 7 vertèbres cervicales (cou), 12 thoraciques (poitrine), 5 lombaires (dos) et 5 sacrées (queue). La moelle épinière envoie des racines qui sortent du canal rachidien entre les corps vertébraux. Les niveaux segmentaires de la moelle épinière sont définis par leurs racines mais ne sont pas toujours situés aux niveaux vertébraux correspondants. Par exemple, le segment de la moelle C8 est situé dans la vertèbre C7 alors que la moelle T12 est située dans la vertèbre T8. Le cordon lombaire est situé entre les vertèbres T9 et T11. La moelle sacrée est située entre les vertèbres T12 et L2, comme le montre la figure 1 Racines rachidiennes. Les racines spinales de C1 sortent de la colonne vertébrale au niveau de la jonction atlanto-occipitale. Les racines spinales de C2 sortent de la colonne vertébrale au niveau de l’axe atlanto. Les racines C3 sortent entre C2 et C3. La racine C8 sort entre C7 et T1. La première racine thoracique ou T1 sort de la moelle épinière entre les corps vertébraux T1 et T2. La racine T12 sort de la moelle épinière entre T1 et L1. La racine L1 sort de la moelle épinière entre les corps vertébraux L1 et L2. La racine L5 sort de la moelle entre les corps L1 et S1.
La moelle cervicale. Les premier et deuxième segments cervicaux sont particuliers car ils maintiennent et font pivoter la tête. L’arrière de la tête est appelé l’occiput. La première vertèbre cervicale, sur laquelle la tête est perchée est parfois appelée Atlas, du nom de la figure mythologique grecque qui soutenait la terre. La deuxième vertèbre cervicale est appelée l’Axe, sur lequel l’Atlas pivote. L’interface entre l’occiput et l’atlas est appelée la jonction atlanto-occipitale. L’interface entre la première et la deuxième vertèbre est appelée la jonction atlanto-axe. La moelle C3-4 contient le noyau phrénique. La moelle cervicale innerve les deltoïdes (C4), les biceps (C4-5), les extenseurs du poignet (C6), les triceps (C7), les extenseurs du poignet (C8) et les muscles de la main (C8-T1).
La moelle thoracique. Les segments vertébraux thoraciques sont définis par ceux qui possèdent une côte. Ces segments vertébraux sont également très particuliers car ils forment la paroi arrière de la cavité pulmonaire et les côtes. Les racines rachidiennes forment les nerfs intercostaux (entre les côtes) qui passent sur la face inférieure des côtes et se connectent aux muscles intercostaux et aux dermatomes associés.
Le cordon lombo-sacré. Les vertèbres lombosacrées forment le reste des segments situés sous les vertèbres du thorax. La moelle épinière lombosacrée, cependant, commence vers T9 et ne se poursuit que jusqu’à L2. Elle contient la plupart des segments qui innervent la hanche et les jambes, ainsi que les fesses et les régions anales.
La Cauda Equina. Chez l’homme, la moelle épinière se termine au niveau vertébral L2. L’extrémité de la moelle épinière est appelée le conus. Sous le conus, il existe une gerbe de racines spinales que l’on appelle fréquemment la cauda equina ou queue de cheval. Les lésions des vertèbres T12 et L1 endommagent la moelle lombaire. Les lésions de la L2 endommagent fréquemment le conus. Les blessures en dessous de L2 impliquent généralement la cauda equina et représentent des blessures aux racines spinales plutôt qu’à la moelle épinière proprement dite.
En résumé, les niveaux segmentaires des vertèbres spinales et de la moelle épinière ne sont pas nécessairement les mêmes. Dans la partie supérieure de la moelle épinière, les deux premiers segments de la moelle cervicale correspondent à peu près aux deux premiers niveaux vertébraux cervicaux. Cependant, les segments C3 à C8 de la moelle épinière sont situés entre les niveaux vertébraux osseux C3 à C7. De même, dans la moelle épinière thoracique, les deux premiers segments de la moelle thoracique correspondent approximativement aux deux premiers niveaux vertébraux thoraciques. Cependant, les segments de la moelle de T3 à T12 sont situés entre T3 et T8. Les segments de la moelle lombaire sont situés aux niveaux T9 à T11 tandis que les segments sacrés sont situés de T12 à L1. L’extrémité de la moelle épinière ou conus est située au niveau de la vertèbre L2. En dessous de L2, il n’y a que des racines spinales, appelées cauda equina.
Niveaux sensoriels versus moteurs
Un dermatome est une parcelle de peau innervée par un niveau de moelle épinière donné. La figure 2 est tirée du manuel de classification de l’ASIA, que l’on peut obtenir sur le site web de l’ASIA. Chaque dermatome a un point spécifique recommandé pour les tests et illustré dans la figure. Après une blessure, les dermatomes peuvent s’étendre ou se contracter, en fonction de la plasticité de la moelle épinière.


Figure 2. Segmentation sensorielle et motrice
de la moelle épinière. Il s’agit des dermatomes
et des muscles recommandés par l’
American Spinal Injury Association.
C2 à C4. Le dermatome C2 couvre l’occiput et la partie supérieure du cou. C3 couvre la partie inférieure du cou jusqu’à la clavicule (l’os horizontal qui va à l’épaule. C4 couvre la zone située juste en dessous de la clavicule. C5 à T1. Ces dermatomes sont tous situés dans les bras. C5 couvre la partie latérale du bras au niveau et au-dessus du coude. C6 couvre l’avant-bras et le côté radial (pouce) de la main. C7 correspond au majeur, C8 aux faces latérales de la main, et T1 couvre la face médiale de l’avant-bras.
T2 à T12. Le thoracique couvre la région axillaire et thoracique. T3 à T12 couvre la poitrine et le dos jusqu’à la ceinture de hanches. Les mamelons sont situés au milieu de T4. T10 est situé au niveau de l’ombilic. T12 se termine juste au-dessus de la ceinture de hanches.
L1 à L5. Le dermatome cutané représentant la ceinture de hanches et la région de l’aine est innervé par la moelle épinière L1. L2 et 3 couvrent la partie antérieure des cuisses. L4 et L5 couvrent les aspects médiaux et latéraux de la jambe inférieure.
S1 à S5. S1 couvre le talon et la partie médiane arrière de la jambe. S2 couvre l’arrière des cuisses. S3 couvre la face médiale des fesses et S4-5 couvre la région périnéale. S5 est bien sûr le dermatome le plus bas et représente la peau immédiatement au niveau et à proximité de l’anus.
Dix groupes musculaires représentent l’innervation motrice par la moelle épinière cervicale et lombosacrée. Le système ASIA n’inclut pas les muscles abdominaux (c’est-à-dire T10-11) car les niveaux thoraciques sont beaucoup plus faciles à déterminer à partir des niveaux sensoriels. Il exclut également certains muscles (par exemple les ischio-jambiers) car les niveaux segmentaires qui les innervent sont déjà représentés par d’autres muscles Les muscles du bras et de la main. C5 représente les fléchisseurs du coude (biceps), C6 les extenseurs du poignet, C7 les extenseurs du coude (triceps), C8 les fléchisseurs des doigts et T1 l’abducteur de l’auriculaire (mouvement vers l’extérieur du petit doigt).
Muscles des jambes et des pieds. Les muscles de la jambe représentent les segments lombaires, c’est-à-dire que L2 sont les fléchisseurs de la hanche (psoas), L3 les extenseurs du genou (quadriceps), L4 les dorsiflecteurs de la cheville (tibialis anterior), L5 les extenseurs du gros orteil (hallucis longus), S1 les fléchisseurs plantaires de la cheville (gastrocnemius).
Le sphincter anal est innervé par le cordon S4-5 et représente la fin de la moelle épinière. Le sphincter anal est une partie essentielle de l’examen de la lésion de la moelle épinière. Si la personne présente une quelconque contraction anale volontaire, indépendamment de toute autre constatation, il s’agit par définition d’une lésion incomplète motrice.
Il est important de noter que les groupes musculaires spécifiés dans les classifications ASIA représentent une simplification excessive de la situation. Presque chaque muscle recevait une innervation de deux segments ou plus.
En résumé, le segment de la moelle épinière dessert des régions motrices et sensorielles spécifiques du corps. Les régions sensorielles sont appelées dermatomes, chaque segment de la moelle épinière innervant une zone particulière de la peau. La répartition de ces dermatomes est relativement simple, sauf sur les membres. Dans les bras, les dermatomes cervicaux C5 à T1 sont disposés de la radiale proximale (C5) à la distale (C6-8) et à la médiale proximale (T1). Dans les jambes, les dermatomes L1 à L5 couvrent l’avant de la jambe de proximal à distal tandis que les dermatomes sacrés couvrent l’arrière de la jambe.
Différences entre les définitions neurologiques et de réadaptation des niveaux de lésion de la moelle épinière. Les médecins utilisent deux définitions différentes des niveaux de lésion de la moelle épinière. Compte tenu du même examen et des mêmes résultats neurologiques, les neurologues et les physiatres peuvent ne pas attribuer le même niveau de lésion de la moelle épinière. En général, les neurologues définissent le niveau de lésion comme le premier niveau segmentaire de la moelle épinière qui présente une perte neurologique anormale. Ainsi, par exemple, si une personne a une perte de biceps, le niveau moteur de la lésion est souvent dit C4. En revanche, les physiatres ou les médecins de réadaptation ont tendance à définir le niveau de lésion comme le niveau segmentaire rachidien le plus bas qui est normal. Ainsi, si un patient présente des sensations C3 normales et une absence de sensation C4, un physiatre dira que le niveau sensoriel est C3 alors qu’un neurologue ou un neurochirurgien parlera d’un niveau de lésion C4. La plupart des chirurgiens orthopédistes ont tendance à se référer au niveau osseux de la blessure comme étant le niveau de blessure.
- Exemple. Les blessures les plus courantes de la colonne cervicale concernent C4 ou C5. Prenons, par exemple, une personne qui a subi une fracture éclatée du corps vertébral C5. Une fracture éclatée indique généralement un traumatisme grave du corps vertébral qui blesse la moelle épinière C6 située au niveau de la vertèbre C5 et également les racines spinales C4 qui sortent de la colonne vertébrale entre les vertèbres C4 et C5. Une telle blessure devrait entraîner une perte de sensations dans le dermatome C4 et une faiblesse des deltoïdes (C4) en raison de la lésion des racines C4. En raison de l’œdème (gonflement de la moelle épinière), le biceps (C5) peut être initialement faible mais devrait récupérer. En revanche, les extenseurs du poignet (C6) devraient rester faibles et la sensation au niveau et en dessous de C6 devrait être gravement compromise. Un neurochirurgien ou un neurologue examinant le patient ci-dessus conclurait généralement à une fracture éclatée à C5 d’après les radiographies, à un niveau sensoriel initial à C4 (le premier dermatome sensoriel anormal) et la perte partielle des deltoïdes et du biceps impliquerait un niveau moteur à C4 (le niveau musculaire anormal le plus élevé). Avec le temps, lorsque le patient récupère les racines de C4 et la moelle épinière de C5, le niveau sensoriel et le niveau moteur devraient se retrouver à C6. Une telle récupération est souvent attribuée à la récupération des « racines ». D’autre part, un physiatre conclurait que le patient a initialement un niveau sensoriel C3, un niveau moteur C4 et un niveau de lésion vertébrale C5. Si le patient récupère la racine C4 et la moelle C5, le physiatre conclura que les niveaux sensoriel et moteur sont tous deux C5. Niveaux discordants de la moelle et des vertèbres thoraciques inférieures. Les niveaux segmentaires des vertèbres et de la moelle épinière deviennent de plus en plus discrets à mesure que l’on descend dans la colonne vertébrale. Par exemple, une lésion vertébrale T8 entraînera une moelle épinière ou un niveau neurologique T12. Une lésion vertébrale T11, en fait, entraînera un niveau de moelle épinière L5. La plupart des patients et même de nombreux médecins ne comprennent pas à quel point les niveaux vertébraux et médullaires peuvent diverger dans la partie inférieure de la moelle épinière.
- Exemple. La lésion de la moelle épinière thoracique la plus courante concerne T11 et T12. Un patient ayant une lésion vertébrale T11 peut avoir ou récupérer des sensations dans les dermatomes L1 à L4 qui incluent l’avant de la jambe jusqu’au niveau du mi-tibia. En outre, un tel patient devrait récupérer les extenseurs de la hanche, les extenseurs du genou et même la dorsiflexion de la cheville. Cependant, les fonctions sacrées, y compris les fonctions intestinales et vésicales, et de nombreuses fonctions de flexion de la jambe peuvent être absentes ou faibles. Comme dans le cas des lésions de la moelle épinière cervicale et thoracique, il est important d’évaluer les fonctions sensorielles et motrices. Lésions du Conus et de la Cauda Equina. Les lésions de la colonne vertébrale au niveau L2 ou inférieur endommageront l’extrémité de la moelle épinière, appelée conus, ou la gerbe de racines spinales qui descendent vers les niveaux vertébraux appropriés pour sortir du canal rachidien ou de l’équin caudal. Veuillez noter que les racines spinales de L2 à S5 descendent toutes dans la cauda equina et qu’une blessure à ces racines perturberait les fibres sensorielles et motrices de ces segments. À proprement parler, les racines spinales font partie du système nerveux périphérique, par opposition à la moelle épinière. Les nerfs périphériques sont censés pouvoir se régénérer dans une certaine mesure. Cependant, les racines spinales sont différentes des nerfs périphériques à deux égards. Premièrement, les neurones dont émanent les axones sensoriels sont situés dans les ganglions de la racine dorsale (DRG), qui se trouvent juste à l’extérieur de la colonne vertébrale. Une branche du DRG va dans la moelle épinière (appelée branche centrale) et l’autre est la branche périphérique. Ainsi, une lésion de la racine épinière endommage la branche centrale du nerf sensitif alors qu’une lésion du nerf périphérique endommage généralement la branche périphérique. L’axone sensoriel doit repousser dans la moelle épinière afin de restaurer la fonction et il ne le fera généralement pas en raison des inhibiteurs de la croissance axonale dans la moelle épinière, en particulier à la jonction PNS-CNS, au niveau de la zone d’entrée de la racine dorsale. Deuxièmement, la cauda equina contient les racines ventrales de la moelle épinière, par lesquelles passent les axones moteurs de la moelle épinière pour innerver les muscles. Si la blessure de la racine ventrale est proche des motoneurones qui envoient les axones, la blessure peut endommager le motoneurone lui-même. Ces deux facteurs réduisent considérablement la probabilité de récupération neurologique dans une lésion de la cauda équine par rapport à une lésion d’un nerf périphérique.
Lésion complète versus lésion incomplète
La plupart des cliniciens décrivent communément les blessures comme « complètes » ou « incomplètes ». Traditionnellement, une lésion médullaire « complète » signifie ne pas avoir de fonction motrice volontaire ou sensorielle consciente en dessous du site de la lésion. Cependant, cette définition est souvent difficile à appliquer. Les trois exemples suivants illustrent les faiblesses et l’ambiguïté de la définition traditionnelle. Le comité de l’ASIA a examiné ces questions lorsqu’il a formulé le système de classification des lésions de la moelle épinière en 1992.
– Zone de préservation partielle. Certaines personnes ont une certaine fonction pour plusieurs segments situés sous le site de la lésion, mais en dessous desquels aucune fonction motrice et sensorielle n’était présente. Cette situation est en fait assez courante. De nombreuses personnes ont des zones de préservation partielle. Une telle personne est-elle » complète » ou » incomplète « , et à quel niveau ?
– La préservation latérale. Une personne peut avoir une préservation partielle de la fonction d’un côté mais pas de l’autre ou à un niveau différent. Par exemple, si une personne a un niveau C4 d’un côté et un niveau T1 de l’autre côté, la personne est-elle complète et à quel niveau ?
– Récupération de la fonction. Une personne peut initialement n’avoir aucune fonction sous le niveau de la lésion mais récupérer une fonction motrice ou sensorielle substantielle sous le site de la lésion. Cette personne a-t-elle subi une lésion médullaire » complète » et est-elle devenue » complète » ? Ce n’est pas une question triviale car si l’on a un essai clinique qui stipule des lésions médullaires » complètes « , il faut stipuler un moment où le statut a été déterminé.
La plupart des cliniciens considèrent qu’une personne est complète si elle a un niveau quelconque en dessous duquel aucune fonction n’est présente. Le comité ASIA a décidé de pousser ce critère jusqu’à sa limite logique, c’est-à-dire que si la personne a n’importe quel niveau vertébral en dessous duquel il n’y a pas de fonction neurologique, cette personne serait classée comme une blessure » complète « . Cela se traduit par une définition simple de la lésion » complète » de la moelle épinière : une personne est » complète » si elle n’a pas de fonction motrice et sensorielle dans la région anale et périnéale représentant la moelle sacrée la plus basse (S4-S5).
La décision de faire de l’absence et de la présence de fonction à S4-5 la définition de la lésion » complète » a non seulement résolu le problème de la zone de préservation partielle mais latérale de la fonction, mais elle a également résolu la question de la récupération de la fonction. Il s’avère que très peu de patients présentant une perte de fonction S4/5 ont récupéré cette fonction spontanément. Comme le montre la figure 3 ci-dessous, bien que cela simplifie le critère permettant d’évaluer si une lésion est » complète « , le comité de classification de l’ASIA a décidé que les niveaux moteur et sensoriel devaient être exprimés de chaque côté séparément, ainsi que la zone de préservation partielle.
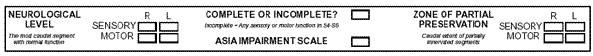
Figure 3. Niveau neurologique, caractère complet et zone de préservation partielle.
En fin de compte, toute la question de la lésion » complète » par rapport à la lésion » incomplète » peut être une question sans objet. L’absence de fonction motrice et sensorielle sous le site de la lésion ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas d’axones qui traversent le site de la lésion. De nombreux cliniciens assimilent une lésion « complète » de la moelle épinière à l’absence d’axones traversant le site de la lésion. Cependant, de nombreuses données animales et cliniques suggèrent qu’un animal ou une personne n’ayant aucune fonction sous le site de la lésion peut récupérer certaines fonctions lorsque la moelle épinière est reperfusée (dans le cas d’une malformation artério-veineuse provoquant une ischémie de la moelle), décompressée (dans le cas d’une moelle épinière chroniquement comprimée) ou traitée avec un médicament tel que la 4-aminopyridine. L’étiquetage d’une personne comme étant « complète » ou « incomplète », à mon avis, ne devrait pas être utilisé pour refuser à une personne l’espoir ou la thérapie.
Classification de la gravité des lésions de la moelle épinière
Les cliniciens utilisent depuis longtemps une échelle clinique pour classer la gravité de la perte neurologique. Conçue pour la première fois à Stokes Manville avant la Seconde Guerre mondiale et popularisée par Frankel dans les années 1970, l’approche originale de notation séparait les patients en cinq catégories, à savoir aucune fonction (A), sensorielle seulement (B), une certaine préservation sensorielle et motrice (C), une fonction motrice utile (D) et normale (E).
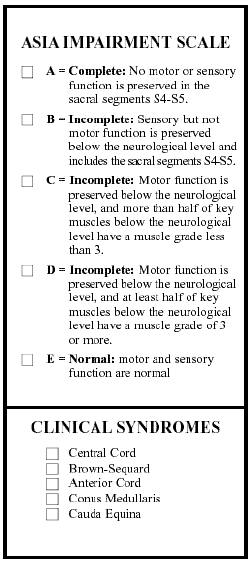
Figure 4. Échelle de déficience de l’ASIA
et syndromes cliniques.
L’échelle de déficience de l’ASIA suit l’échelle de Frankel mais diffère de l’ancienne échelle sur plusieurs points importants. Tout d’abord, au lieu d’une absence de fonction en dessous du niveau de la lésion, l’ASIA A est définie comme une personne n’ayant aucune fonction motrice ou sensorielle préservée dans les segments sacrés S4-S5. Cette définition est claire et sans ambiguïté. L’ASIA B est essentiellement identique à l’ASIA B de Frankel, mais ajoute l’exigence d’une fonction sacrée S4-S5 préservée. Il convient de noter que la classification ASIA A et B dépend entièrement d’une seule observation, à savoir la préservation de la fonction motrice et sensorielle de S4-5. L’échelle ASIA a également ajouté des critères quantitatifs pour C et D. L’échelle originale de Frankel demandait aux cliniciens d’évaluer l’utilité de la fonction des membres inférieurs. Cela a non seulement introduit un élément subjectif dans l’échelle, mais a également ignoré la fonction du bras et de la main chez les patients atteints de lésions de la moelle épinière cervicale. Pour contourner ce problème, l’ASIA a stipulé qu’un patient serait un ASIA C si plus de la moitié des muscles évalués avaient une note inférieure à 3/5. Dans le cas contraire, la personne était affectée à l’ASIA D.
L’ASIA E est intéressante car elle implique que quelqu’un peut avoir une lésion de la moelle épinière sans avoir de déficits neurologiques au moins détectables lors d’un examen neurologique de ce type. De plus, le scoring moteur et sensoriel ASIA peut ne pas être sensible à une faiblesse subtile, à la présence de spasticité, à la douleur et à certaines formes de dyesthésie qui pourraient résulter d’une lésion de la moelle épinière. Notez qu’une telle personne serait classée dans la catégorie ASIA E.
Ces changements dans l’échelle ASIA ont considérablement amélioré la fiabilité et la cohérence de la classification. Bien qu’elle soit plus logique, la nouvelle définition de la blessure » complète » ne signifie pas nécessairement qu’elle reflète mieux la gravité de la blessure. Par exemple, existe-t-il une situation où une personne pourrait être un ASIA B et mieux que l’ASIA C ou même l’ASIA D ?
La nouvelle catégorisation ASIA A s’avère être plus prédictive du pronostic que la définition précédente où la présence d’une fonction de plusieurs segments sous le site de la lésion mais l’absence de fonction en dessous d’un niveau donné pouvait être interprétée comme une lésion médullaire » incomplète « .
Le comité ASIA a également classé les lésions médullaires incomplètes en cinq types. Un syndrome cordonal central est associé à une plus grande perte de fonction des membres supérieurs par rapport aux membres inférieurs. Le syndrome de Brown-Sequard résulte d’une lésion par hémisection de la moelle épinière. Le syndrome cordonal antérieur se produit lorsque la lésion touche les voies spinales antérieures, y compris les voies vestibulospnéales. Les syndromes du conus medullaris et de la cauda equina surviennent en cas de lésion du conus ou des racines spinales de la moelle.
Conclusion
Une grande confusion entoure la terminologie associée aux niveaux, à la gravité et à la classification des lésions de la moelle épinière. L’American Spinal Injury Association a essayé de trier certaines de ces questions et de normaliser le langage utilisé pour décrire les lésions de la moelle épinière. La méthode de classification des lésions de la moelle épinière de l’ASIA a maintenant été adoptée par presque toutes les grandes organisations associées aux lésions de la moelle épinière. Cela a permis d’utiliser une terminologie plus cohérente pour décrire les résultats des lésions de la moelle épinière dans le monde entier.