
Lydia Maria Child a introduit le personnage littéraire que l’on appelle le mulâtre tragique1 dans deux nouvelles : » Les quadrillons » (1842) et » Les maisons agréables de l’esclavage » (1843). Elle dépeint cette femme à la peau claire comme la progéniture d’un esclavagiste blanc et de son esclave féminine noire. La vie de cette mulâtresse était en effet tragique. Elle ignorait à la fois la race de sa mère et la sienne. Elle se croyait blanche et libre. Son cœur était pur, ses manières impeccables, sa langue polie et son visage magnifique. Son père est mort ; son « sang nègre » a été découvert, elle a été renvoyée à l’esclavage, abandonnée par son amant blanc et est morte victime de l’esclavage et de la violence des hommes blancs. Une représentation similaire du mulâtre presque blanc apparaît dans Clotel (1853), un roman écrit par l’abolitionniste noir William Wells Brown.

Un siècle plus tard, les représentations littéraires et cinématographiques de la mulâtresse tragique mettent l’accent sur ses pathologies personnelles : haine de soi, dépression, alcoolisme, perversion sexuelle et tentatives de suicide étant les plus courantes. Si elle était assez claire pour « passer » pour une blanche, elle le faisait, mais le fait de passer ne faisait qu’aggraver son dégoût de soi. Elle plaignait ou méprisait les Noirs et la « noirceur » en elle ; elle détestait ou craignait les Blancs, mais recherchait désespérément leur approbation. Dans une société fondée sur la race, la mulâtresse tragique ne trouvait la paix que dans la mort. Elle suscitait la pitié ou le mépris, pas la sympathie. Sterling Brown a résumé le traitement du mulâtre tragique par les écrivains blancs :
Les écrivains blancs insistent sur le malheur du mulâtre pour d’autres raisons. Pour eux, il est la victime angoissée du partage de l’héritage. Mathématiquement, ils s’arrangent pour que ses efforts intellectuels et sa maîtrise de soi viennent de son sang blanc, et que ses urgences émotionnelles, son indolence et sa sauvagerie potentielle viennent de son sang noir. Leur personnage préféré, l’octoroune, misérable à cause de la » seule goutte de minuit dans ses veines « , désire par-dessus tout un amant blanc et doit donc connaître une fin tragique.(Brown, 1969, p. 145)
Le roman de Vara Caspary, The White Girl (1929), raconte l’histoire de Solaria, une belle mulâtre qui se fait passer pour blanche. Son secret est révélé par l’apparition de son frère à la peau brune. Déprimée, et croyant que sa peau s’assombrit, Solaria boit du poison. Un personnage mulâtre plus réaliste mais tout aussi déprimant se trouve dans le roman Dark Lustre (1932) de Geoffrey Barnes. Alpine, l' »héroïne » à la peau claire, meurt en couches, mais son bébé blanc vit pour poursuivre « un cycle de douleur ». Solaria et Alpine sont toutes deux repoussées par les Noirs, en particulier par les prétendants noirs.
La plupart des mulâtres tragiques étaient des femmes, bien que le sergent Waters, qui se déteste, dans A Soldier’s Story (Jewison, 1984) corresponde clairement au stéréotype du mulâtre tragique. Le mulâtre troublé est dépeint comme une femme égoïste prête à tout abandonner, y compris sa famille noire, pour vivre comme une personne blanche. Ces mots sont illustratifs :
Ne venez pas me chercher. Si vous me voyez dans la rue, ne me parlez pas. A partir de maintenant, je suis Blanche. Je ne suis pas de couleur. Vous devez me laisser tomber.
Ces mots ont été prononcés par Peola, une jeune fille noire torturée et qui se déteste dans le film Imitation of Life (Laemmle & Stahl, 1934). Peola, jouée adroitement par Fredi Washington, avait une peau d’apparence blanche. Mais elle n’était pas socialement blanche. Elle était une mulâtre. Peola en avait assez d’être traitée comme une citoyenne de seconde zone, c’est-à-dire d’être traitée comme un Noir américain des années 1930. Elle se fit passer pour blanche et supplia sa mère de comprendre.
Imitation of Life, basé sur le roman à succès de Fannie Hurst, retrace la vie de deux veuves, l’une blanche et employeuse, l’autre noire et servante. Chaque femme a une fille. La femme blanche, Beatrice Pullman (jouée par Claudette Colbert), engage la femme noire, Delilah, (jouée par Louise Beavers) comme cuisinière et gouvernante à demeure. C’est la dépression, et les deux femmes et leurs filles vivent dans la pauvreté – même une femme blanche en difficulté financière peut s’offrir une maman. Leur salut économique arrive lorsque Delilah partage une recette secrète de crêpes avec son patron. Béatrice ouvre un restaurant, commercialise la recette et devient rapidement riche. Elle offre à Delilah, la cuisinière du restaurant, une part de vingt pour cent des bénéfices. Au sujet de la recette, Delilah, véritable mamie du cinéma, prononce deux des répliques les plus pathétiques jamais prononcées par un personnage noir : « Je te la donne, chérie. Je t’en fais cadeau. » Alors que Delilah garde intacte la famille de sa maîtresse, sa relation avec Peola, sa fille, se désintègre.
Peola est l’antithèse de la caricature de la maman. Delilah connaît sa place dans la hiérarchie Jim Crow : l’échelon inférieur. La sienne est une résignation accommodante, à la limite du contentement. Peola déteste sa vie, elle en veut plus, elle veut vivre comme une personne blanche, avoir les opportunités dont jouissent les Blancs. Delilah espère que sa fille acceptera son héritage racial. « Il t’a faite noire, chérie. Ne lui raconte pas ses affaires. Accepte-le, chérie. » Peola veut être aimée par un homme blanc, épouser un homme blanc. Elle est belle, sensuelle, une épouse potentielle pour tout homme blanc qui ne connaît pas son secret. Peola veut vivre sans le stigmate d’être noire – et dans les années 1930, ce stigmate était réel et mesurable. En fin de compte et inévitablement, Peola rejette sa mère, s’enfuit et se fait passer pour blanche. Delilah meurt d’un cœur brisé. Une Peola repentante et en larmes revient à l’enterrement de sa mère.
Les spectateurs, noirs et blancs (et ils étaient séparés), ont détesté ce que Peola a fait à sa mère — et ils ont détesté Peola. Elle est souvent dépeinte comme l’incarnation de l’égoïsme. Dans de nombreuses discussions académiques sur les mulâtres tragiques, le nom de Peola est inclus. Du milieu des années 1930 à la fin des années 1970, Peola était un épithète utilisé par les Noirs contre les femmes noires à la peau claire qui s’identifiaient à la société blanche dominante. Une Peola avait l’air blanche et voulait être blanche. Pendant le Mouvement des droits civiques et le Black Power Movement, le nom Peola était une insulte comparable à celle de l’Oncle Tom, bien qu’il s’agisse d’une version féminine à la peau claire.

Fredi Washington, l’actrice noire qui jouait Peola, était assez claire pour passer pour blanche. La rumeur veut que, dans les films ultérieurs, du maquillage ait été utilisé pour « noircir » sa peau afin que les spectateurs blancs connaissent sa race. Elle avait des traits très marqués, des cheveux longs, foncés et raides, et des yeux verts, ce qui limitait les rôles qu’on lui proposait. Elle ne pouvait pas jouer des rôles de mamans, et bien qu’elle ait l’air blanche, aucun noir reconnu n’était autorisé à jouer un blanc des années 1930 aux années 1950.
Imitation of Life a fait l’objet d’un remake en 1959 (Hunter & Sirk). L’intrigue est essentiellement la même ; cependant, Peola s’appelle Sara Jane, et elle est jouée par Susan Kohner, une actrice blanche. Delilah est maintenant Annie Johnson. L’histoire des crêpes a disparu. À la place, la maîtresse blanche est une actrice en difficulté. Le cœur de l’histoire reste les tentatives de la fille à la peau claire de passer pour une blanche. Elle s’enfuit et devient choriste dans une boîte de nuit sordide. Sa mère à la peau foncée (jouée par Juanita Moore) la suit. Elle supplie sa mère de la laisser tranquille. Sara Jane ne veut pas épouser un « chauffeur de couleur » ; elle veut un petit ami blanc. Elle trouve un petit ami blanc, mais lorsqu’il découvre son secret, il la bat sauvagement et l’abandonne dans un caniveau. Comme dans l’original, la mère de Sara Jane meurt d’un cœur brisé, et l’enfant repentante revient en larmes aux funérailles.
Peola et Sara Jane étaient des mulâtres tragiques cinématographiques. Elles étaient des testaments sur grand écran de la croyance communément admise que le » sang mêlé » apportait le chagrin. Si seulement elles n’avaient pas une « goutte de sang nègre ». De nombreux spectateurs ont acquiescé lorsque Annie Johnson a posé la question rhétorique suivante : « Comment expliquez-vous à votre fille qu’elle est née pour faire mal ? »
Les vrais mulâtres étaient-ils nés pour faire mal ? Toutes les minorités raciales aux États-Unis ont été victimes du groupe dominant, même si les expressions de cette oppression varient. Les mulâtres étaient considérés comme des Noirs ; ils étaient donc des esclaves au même titre que leurs congénères plus foncés. Tous les esclaves étaient « nés pour souffrir », mais certains auteurs ont affirmé que les mulâtres étaient privilégiés par rapport aux Noirs à la peau foncée. E.B. Reuter (1919), un historien, a écrit :
A l’époque de l’esclavage, ils étaient le plus souvent les domestiques formés et avaient les avantages d’un contact quotidien avec des hommes et des femmes cultivés. Beaucoup d’entre eux étaient libres et bénéficiaient donc de tous les avantages liés à ce statut supérieur. Ils étaient considérés par les Blancs comme étant d’une intelligence supérieure à celle des Nègres noirs et en venaient à tirer une grande fierté du fait de leur sang blanc….. Lorsque cela était possible, ils formaient une sorte de caste métisse et se tenaient à l’écart des Nègres noirs et des esclaves de statut inférieur. (p. 378)

L’affirmation de Reuter selon laquelle les mulâtres étaient tenus en plus haute estime et mieux traités que les « Noirs purs » doit être examinée de près. L’esclavage américain a duré plus de deux siècles ; il est donc difficile de faire des généralisations sur cette institution. Les interactions entre les propriétaires d’esclaves et les esclaves variaient d’une décennie à l’autre – et d’une plantation à l’autre. Néanmoins, il existe des indices concernant le statut des mulâtres. Dans une variété de déclarations publiques et de lois, les enfants issus de relations sexuelles entre Blancs et Noirs étaient qualifiés de « bâtards » ou de « faux » (Nash, 1974, p. 287). De plus, ces enfants interraciaux étaient toujours définis juridiquement comme de purs Noirs, ce qui était différent de la façon dont ils étaient traités dans les autres pays du Nouveau Monde. Un propriétaire d’esclaves affirmait qu’il n’y avait « pas une seule vieille plantation dans laquelle les petits-enfants du propriétaire ne sont pas fouettés dans les champs par son surveillant » (Furnas, 1956, p. 142). De plus, il semble que les femmes mulâtres étaient parfois la cible d’abus sexuels.
Selon l’historien J. C. Furnas (1956), sur certains marchés d’esclaves, les mulâtres et les quadrons rapportaient des prix plus élevés, en raison de leur utilisation comme objets sexuels (p. 149). Certains esclavagistes trouvaient la peau foncée vulgaire et repoussante. Le mulâtre se rapprochait de l’idéal blanc de l’attractivité féminine. Toutes les femmes esclaves (ainsi que les hommes et les enfants) étaient susceptibles d’être violées, mais le mulâtre offrait au propriétaire d’esclaves la possibilité de violer, en toute impunité, une femme qui était physiquement blanche (ou presque) mais légalement noire. Une plus grande probabilité d’être violée n’est certainement pas une indication de statut favorisé.
La femme mulâtre était dépeinte comme une séductrice dont la beauté poussait les hommes blancs à la violer. Il s’agit d’une tentative évidente et défectueuse de concilier les interdictions du métissage (relations sexuelles interraciales) avec la réalité selon laquelle les Blancs utilisaient couramment les Noirs comme objets sexuels. Un esclavagiste a noté : « Il n’y a pas une seule fille à l’allure convenable dans cet État qui ne soit pas la concubine d’un Blanc… ». (Furnas, 1956, p. 142). Chaque mulâtre était la preuve que la ligne de couleur avait été franchie. À cet égard, les mulâtres étaient des symboles de viol et de concubinage. Gary B. Nash (1974) a résumé la relation qui existait à l’époque de l’esclavage entre le viol des femmes noires, la manipulation des mulâtres et la domination blanche :
Bien que la couleur de la peau en soit venue à prendre de l’importance à travers des générations d’association avec l’esclavage, les colons blancs ont développé peu de scrupules à l’égard des contacts intimes avec les femmes noires. Mais l’élévation du statut social de ceux qui travaillaient au bas de l’échelle sociale et qui étaient définis comme abyssalement inférieurs était un sujet de préoccupation sérieux. Le problème a été résolu en veillant à ce que le mulâtre n’occupe pas une position intermédiaire entre le blanc et le noir. Tout sang noir classait une personne comme noire ; et être noir, c’était être un esclave….. En interdisant les mariages interraciaux, en faisant un clin d’œil aux relations sexuelles interraciales et en définissant toute progéniture métissée comme noire, la société blanche a trouvé la réponse idéale à ses besoins de main-d’œuvre, à ses désirs sexuels extra-scolaires et inadmissibles, à sa contrainte de maintenir sa culture de race pure et au problème du maintien, au moins en théorie, d’un contrôle social absolu. (pp. 289-290)
George M. Fredrickson (1971), auteur de The Black Image in the White Mind, affirmait que de nombreux Américains blancs croyaient que les mulâtres étaient une race dégénérée parce qu’ils avaient du « sang blanc », qui les rendait ambitieux et avides de pouvoir, combiné à du « sang noir » qui les rendait animalistes et sauvages. L’attribution des traits de personnalité et de moralité au « sang » semble insensée aujourd’hui, mais elle était prise au sérieux dans le passé. Charles Carroll, auteur de The Negro a Beast (1900), décrivait les Noirs comme des êtres semblables à des animaux. Quant aux mulâtres, issus de « relations contre nature », ils n’avaient pas « le droit de vivre » car, selon Carroll, ils constituaient la majorité des violeurs et des tueurs (Fredrickson, 1971, p. 277). Son affirmation était fausse, mais largement répandue. En 1899, une femme blanche du Sud, L. H. Harris, écrivait au rédacteur en chef de l’Independent que la « brute nègre » qui violait les femmes blanches était « presque toujours un mulâtre », avec « suffisamment de sang blanc en lui pour remplacer l’humilité et la lâcheté indigènes par l’audace caucasienne » (Fredrickson, 1971, p. 277). Les femmes mulâtres étaient dépeintes comme des séductrices émotionnellement troublées et les hommes mulâtres comme des criminels avides de pouvoir. Ces représentations ne sont nulle part plus évidentes que dans le film de D. W. Griffith, The Birth of a Nation (1915).
La naissance d’une nation est sans doute le film grand public le plus raciste produit aux États-Unis. Ce mélodrame de la guerre civile et de la Reconstruction a justifié et glorifié le Ku Klux Klan. En effet, le Klan des années 1920 doit son existence à William Joseph Simmons, un prédicateur méthodiste itinérant qui a regardé le film une douzaine de fois, puis s’est senti divinement inspiré pour ressusciter le Klan qui était en sommeil depuis 1871. D. W. Griffith a basé le film sur le roman anti-noir de Thomas Dixon, The Clansman (1905) (également le titre original du film). Griffith, suivant l’exemple de Dixon, a dépeint ses personnages noirs comme étant soit des « darkies loyaux », soit des brutes et des bêtes assoiffées de pouvoir et, pire encore, convoitant les femmes blanches.
La naissance d’une nation raconte l’histoire de deux familles, les Stoneman de Pennsylvanie, et les Cameron de Caroline du Sud. Les Stoneman, dirigés par le politicien Austin Stoneman, et les Cameron, dirigés par l’esclavagiste « Petit Colonel » Ben Cameron, voient leur amitié de longue date divisée par la guerre civile. La guerre civile fait payer un lourd tribut aux deux familles : leurs fils meurent à la guerre. Les Cameron, comme de nombreux esclavagistes, souffrent de « ruine, dévastation, rapine et pillage ». The Birth of a Nation dépeint la Reconstruction radicale comme une période où les Noirs dominent et oppriment les Blancs. Le film montre des Noirs qui poussent les Blancs hors des trottoirs, leur arrachent leurs biens, tentent de violer une adolescente blanche et tuent les Noirs qui sont loyaux envers les Blancs (Leab, 1976, p. 28). Stoneman, un carpetbagger, déplace sa famille dans le Sud. Il tombe sous l’influence de Lydia, sa gouvernante et maîtresse mulâtre.
Austin Stoneman est dépeint comme un politicien naïf qui trahit son peuple : les Blancs. Lydia, son amante, est décrite dans un sous-titre comme la « faiblesse qui doit flétrir une nation ». Stoneman envoie un autre mulâtre, Silas Lynch, pour « aider les carpetbaggers à s’organiser et à exercer le pouvoir du vote ». Lynch, en raison de son « sang blanc », devient ambitieux. Lui et ses agents mettent en colère les Noirs locaux. Ils attaquent les Blancs et pillent. Lynch devient lieutenant-gouverneur, et ses co-conspirateurs noirs sont élus à des postes politiques au niveau de l’État. The Birth of a Nation montre des législateurs noirs débattant d’un projet de loi visant à légaliser le mariage interracial — les jambes appuyées sur des tables, mangeant du poulet et buvant du whisky.
Silas Lynch propose le mariage à la fille de Stoneman, Elsie. Il lui dit : « Je vais construire un empire noir et toi, en tant que reine, tu régneras à mes côtés. » Lorsqu’elle refuse, il l’attache et décide d’un « mariage forcé ». Lynch informe Stoneman qu’il veut épouser une femme blanche. Stoneman approuve jusqu’à ce qu’il découvre que la femme blanche est sa fille. Pendant que ce drame se déroule, les Noirs attaquent les Blancs. La situation semble sans espoir jusqu’à ce que le Ku Klux Klan, nouvellement formé, arrive pour rétablir la domination blanche.
La Naissance d’une nation a établi la norme en matière d’innovation technique cinématographique — l’utilisation imaginative des coupes transversales, de l’éclairage, du montage et des gros plans. Il a également établi la norme pour les images cinématographiques anti-noires. Toutes les principales caricatures de Noirs sont présentes dans le film, y compris les mamans, les sambos, les toms, les picaninnies, les coons, les bêtes et les mulâtres tragiques. Les représentations de Lydia — une séductrice haineuse au cœur froid — et de Silas Lynch — un criminel avide de pouvoir et obsédé par le sexe — sont les premiers exemples des pathologies supposées inhérentes au stéréotype du mulâtre tragique.
Les mulâtres ne s’en sortaient pas mieux dans d’autres livres et films, surtout ceux qui passaient pour blancs. Dans le roman Passing (1929) de Nella Larsen, Clare, une mulâtresse se faisant passer pour blanche, est fréquemment attirée par les Noirs de Harlem. Son mari blanc et bigot la retrouve là. Ses problèmes sont résolus lorsqu’elle fait une chute mortelle d’une fenêtre du sixième étage. Dans le film Show Boat (Laemmle & Whale, 1936), une belle jeune artiste de spectacle, Julie, découvre qu’elle a du « sang noir ». Selon les lois en vigueur, « une goutte de sang nègre fait de vous un nègre ». Son mari (ainsi que les scénaristes et le producteur du film) prennent cette « règle de la goutte » au pied de la lettre. Le mari lui coupe la main avec un couteau et suce son sang. Cela fait soi-disant de lui un Noir. Par la suite, Julie et son mari nouvellement mulâtre marchent main dans la main. Néanmoins, elle est un mulâtre à l’écran, et le film se termine donc avec cette femme « blanche » autrefois joyeuse, devenue un Noir alcoolique.
Les Limites perdues est un livre de William L. White (1948), porté au cinéma en 1949 (de Rochemont & Werker). Il raconte l’histoire d’un couple de mulâtres à problèmes, les Johnsons. Le mari est médecin, mais il ne peut pas obtenir un emploi dans un hôpital noir du Sud parce qu’il » a l’air blanc « , et aucun hôpital blanc du Sud ne veut l’embaucher. Les Johnson déménagent en Nouvelle-Angleterre et se font passer pour des Blancs. Ils deviennent des piliers de leur communauté locale, tout en étant terrifiés à l’idée d’être discrédités. Des années plus tard, lorsque leur secret est découvert, les habitants de la ville se retournent contre eux. Le pasteur blanc de la ville prononce un sermon sur la tolérance raciale qui amène les habitants, honteux et culpabilisés, à se lier à nouveau d’amitié avec le couple mulâtre. Lost Boundaries, malgré le sermon du pasteur blanc, rend le couple mulâtre, et non une culture raciste, responsable de la discrimination et des conflits personnels auxquels sont confrontés les Johnson.

En 1958, Natalie Wood joue dans Kings Go Forth (Ross & Daves), l’histoire d’une jeune mulâtresse française qui se fait passer pour blanche. Elle se lie avec deux soldats américains en permission de la Seconde Guerre mondiale. Ils s’éprennent d’elle jusqu’à ce qu’ils découvrent que son père est noir. Les deux hommes l’abandonnent. Elle tente de se suicider, sans succès. Ayant une autre chance de vivre, elle transforme la grande maison de sa famille en un foyer pour orphelins de guerre, « ceux qui sont tout aussi privés d’amour qu’elle » (Bogle, 1994, p. 192). À la fin du film, l’un des soldats est mort ; l’autre, auquel il manque un bras, revient auprès de la femme mulâtre. Ils sont comparables, tous deux abîmés, et il est sous-entendu qu’ils vont se marier.
Les femmes mulâtres représentées dans Show Boat, Lost Boundaries et Kings Go Forth étaient interprétées par des actrices blanches. Il s’agissait d’une pratique courante. Les producteurs estimaient que le public blanc éprouverait de la sympathie pour une femme blanche torturée, même si elle incarnait un personnage mulâtre. Le public savait qu’elle était réellement blanche. Dans Pinky (Zanuck & Kazan, 1949), Jeanne Crain, une actrice connue, jouait le rôle de la mulâtresse tourmentée. Sa grand-mère à la peau foncée était jouée par Ethel Waters. Lorsque les spectateurs voyaient Ethel Waters effectuer des travaux subalternes, cela correspondait à leur conception de la vie d’une maman, mais lorsque Jeanne Crain était montrée en train de laver les vêtements d’autres personnes, les spectateurs pleuraient.
Même des cinéastes noirs comme Oscar Micheaux ont fait des films avec des mulâtres tragiques. Within Our Gates (Micheaux, 1920) raconte l’histoire d’une femme mulâtre qui est renversée par une voiture, menacée par un escroc, presque violée par un homme blanc, et qui assiste au lynchage de toute sa famille. God’s Step Children (Micheaux, 1938) raconte l’histoire de Naomi, une mulâtre qui quitte son mari noir et son enfant et se fait passer pour blanche. Plus tard, rongée par la culpabilité, elle se suicide. Ce sont des actrices mulâtres qui ont joué ces rôles.
 Fredi Washington, la star d’Imitation of Life, fut l’une des premières mulâtresses tragiques du cinéma. Elle a été suivie par des femmes comme Dorothy Dandridge et Nina Mae McKinney. Dorothy Dandridge mérite une attention particulière car elle n’a pas seulement incarné des femmes condamnées et insatisfaites, mais elle était aussi l’incarnation du mulâtre tragique dans la vie réelle. Son rôle de personnage principal dans Carmen Jones (Preminger, 1954) a contribué à faire d’elle une star. Elle est la première Noire à figurer sur la couverture du magazine Life. Dans L’île au soleil (Zanuck & Rossen, 1957), elle fut la première femme noire à être tenue — amoureusement — dans les bras d’un homme blanc dans un film américain. Elle était une actrice belle et talentueuse, mais Hollywood n’était pas prête pour une vedette noire ; les seuls rôles qui lui ont été offerts étaient des variantes du thème du mulâtre tragique. Sa vie personnelle est jalonnée de relations ratées. Désabusée par des rôles qui la limitaient à des types de mulâtres exotiques et autodestructeurs, elle est partie en Europe, où elle a connu pire. Elle meurt en 1965, à l’âge de quarante-deux ans, d’une overdose d’antidépresseurs.
Fredi Washington, la star d’Imitation of Life, fut l’une des premières mulâtresses tragiques du cinéma. Elle a été suivie par des femmes comme Dorothy Dandridge et Nina Mae McKinney. Dorothy Dandridge mérite une attention particulière car elle n’a pas seulement incarné des femmes condamnées et insatisfaites, mais elle était aussi l’incarnation du mulâtre tragique dans la vie réelle. Son rôle de personnage principal dans Carmen Jones (Preminger, 1954) a contribué à faire d’elle une star. Elle est la première Noire à figurer sur la couverture du magazine Life. Dans L’île au soleil (Zanuck & Rossen, 1957), elle fut la première femme noire à être tenue — amoureusement — dans les bras d’un homme blanc dans un film américain. Elle était une actrice belle et talentueuse, mais Hollywood n’était pas prête pour une vedette noire ; les seuls rôles qui lui ont été offerts étaient des variantes du thème du mulâtre tragique. Sa vie personnelle est jalonnée de relations ratées. Désabusée par des rôles qui la limitaient à des types de mulâtres exotiques et autodestructeurs, elle est partie en Europe, où elle a connu pire. Elle meurt en 1965, à l’âge de quarante-deux ans, d’une overdose d’antidépresseurs.
Les actrices mulâtres à succès d’aujourd’hui — par exemple, Halle Berry, Lisa Bonet et Jasmine Guy — ont une dette envers les efforts pionniers de Dandridge. Ces femmes sont très riches et célèbres. Elles sont bi-raciales, mais leur statut et leur situation ne sont pas tragiques. Elles ne sont pas marginalisées ; ce sont des célébrités grand public. Des actrices à la peau foncée – Whoopi Goldberg, Angela Bassett, Alfre Woodard et Joie Lee – ont connu un succès comparable. Elles bénéficient, elles aussi, du défrichage du chemin par Dandridge.

Le mulâtre tragique était plus un mythe qu’une réalité ; Dandridge était une exception. Le mulâtre était rendu tragique dans l’esprit des Blancs qui raisonnaient que la plus grande tragédie était d’être presque blanc : si proche, et pourtant à un gouffre racial de distance. Le presque-blanc était à plaindre – et à fuir. Il y avait sans aucun doute des Noirs à la peau claire, hommes et femmes, qui se sentaient marginalisés dans cette culture soucieuse de la race. C’était vrai pour de nombreuses personnes de couleur, y compris les Noirs à la peau foncée. La haine de soi et la haine intraraciale ne sont pas limitées aux Noirs à la peau claire. Il existe des preuves que toutes les minorités raciales aux États-Unis ont lutté contre des sentiments d’infériorité et d’animosité au sein du groupe ; ce sont, malheureusement, les coûts d’être une minorité.
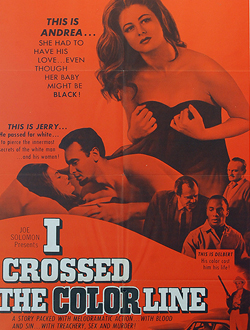
Le stéréotype tragique du mulâtre prétend que les mulâtres occupent les marges de deux mondes, ne s’adaptant à aucun, n’étant acceptés par aucun. Ce n’est pas le cas des mulâtres de la vie réelle. Historiquement, les mulâtres n’étaient pas seulement acceptés dans la communauté noire, mais étaient souvent ses leaders et ses porte-parole, tant au niveau national qu’au niveau des quartiers. Frederick Douglass, W.E.B. DuBois, Booker T. Washington, Elizabeth Ross Hayes2, Mary Church Terrell3, Thurgood Marshall, Malcolm X et Louis Farrakhan étaient tous des mulâtres. Walter White, l’ancien chef de la NAACP, et Adam Clayton Powell, un membre du Congrès au franc-parler, étaient tous deux suffisamment clairs pour passer pour des Blancs. Parmi les autres mulâtres notables figurent Langston Hughes, Billie Holiday et Jean Toomer, auteur de Cane (1923) et petit-fils du politicien mulâtre de la Reconstruction P.B.S. Pinchback.
Il y avait une tragédie dans la vie des femmes noires à la peau claire — il y avait aussi une tragédie dans la vie de la plupart des femmes noires à la peau foncée — et des hommes et des enfants. La tragédie n’était pas qu’ils étaient noirs, ou qu’ils avaient une goutte de « sang nègre », bien que les Blancs considéraient cela comme une tragédie. La véritable tragédie était plutôt la façon dont la race était utilisée pour limiter les chances des personnes de couleur. Le 21e siècle trouve une Amérique de plus en plus tolérante envers les unions interraciales et la progéniture qui en résulte.
© Dr. David Pilgrim, professeur de sociologie
Ferris State University
Nov., 2000
Édition 2012
1 Un mulâtre est défini comme : la première progéniture générale d’un parent noir et d’un parent blanc ; ou, un individu ayant des ancêtres blancs et noirs. En général, les mulâtres ont la peau claire, bien que suffisamment foncée pour être exclue de la race blanche.
2 Elizabeth Ross Hayes était une travailleuse sociale, une sociologue et une pionnière du mouvement YWCA.
3 Mary Church Terrell était une féministe, une militante des droits civiques et la première présidente de la National Association of Colored Women.
Barnes, G. (1932). Dark lustre. New York, NY : A. H. King.
Bogle. D. (1994). Toms, coons, mulâtres, mammies, & bucks : Une histoire interprétative des Noirs dans les films américains. New York, NY : Continuum.
Brown, S. (1969). La poésie et le théâtre nègres et le nègre dans la fiction américaine. New York, NY : Atheneum.
Brown, W. W. (1853). Clotel, ou, La fille du président : un récit de la vie des esclaves aux États-Unis. Londres : Partridge & Oakley.
Carroll, C. (1900). « Le nègre une bête » ; ou, « A l’image de Dieu ». St. Louis, MO : American Book and Bible House.
Caspary, V. (1929). La fille blanche. New York, NY : J. H. Sears & Co.
De Rochemont, L. (producteur), & Werker, A. L. (réalisateur). (1949). Lost boundaries . États-Unis : Louis De Rochemont Associés.
Dixon, T. (1905). Le clansman : une romance historique du Ku Klux Klan. New York, NY : Grosset & Dunlap.
Fredrickson, G. M. (1971). L’image noire dans l’esprit blanc : Le débat sur le caractère et le destin afro-américain 1817-1914. New York, NY : Harper & Row.
Furnas, J. C. (1956). Goodbye to Uncle Tom. New York, NY : Apollo, 1956.
Griffith, D. W. (producteur/réalisateur) (1915). La naissance d’une nation . États-Unis : David W. Griffith Corp.
Hunter, R. (producteur), & Sirk, D. (réalisateur). (1959). Imitation of life . États-Unis : Universal International Pictures.
Hurst. F. (1933). L’imitation de la vie, un roman. New York, NY : Harper & Bros.
Jewison, N. (producteur/réalisateur). (1984). L’histoire d’un soldat . États-Unis : Columbia Pictures Corporation.
Laemmle, C. Jr. (producteur), & Stahl, J. M. (réalisateur). (1934). Imitation of life . États-Unis : Universal Pictures.
Laemmle, C. Jr. (producteur), & Whale, J. (réalisateur). (1936). Show boat . États-Unis : Universal Pictures.
Larsen, N. (1929). Passing. New York, NY : Alfred A. Knopf.
Leab, D. (1976). De Sambo à Superspade : l’expérience noire dans les films de cinéma. Boston, MA : Houghton Mifflin.
Micheaux, O. (producteur/réalisateur). (1938). Les beaux enfants de Dieu . États-Unis : Micheaux Film.
Micheaux, O. (Producteur/Réalisateur). (1920). Within our gates . États-Unis : Micheaux Book & Film Company.
Nash, G. B. (1974). Rouge, blanc et noir : Les peuples de l’Amérique primitive. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall.
Preminger, O. (Producteur/Réalisateur). (1954). Carmen Jones . États-Unis : Carlyle Productions.
Reuter, E. B. (1918). Le mulâtre aux États-Unis. Boston, MA : Badger.
Ross, F. (producteur), & Daves, D. (réalisateur). (1958). Kings go forth . États-Unis : Frank Ross-Eton Productions.
Toomer, J. (1923). Cane. New York, NY : Boni and Liveright.
White, W. L. (1948). Les frontières perdues. New York, NY : Harcourt, Brace.
Zanuck, D. F. (producteur), & Kazan, E. (réalisateur). (1949). Pinky . États-Unis : Twentieth Century Fox Film Corporation.
Zanuck, D. F. (producteur), & Rossen, R. (réalisateur). (1957). L’île au soleil . États-Unis : Darryl F. Zanuck Productions.
Retour à l’accueil de la MJC